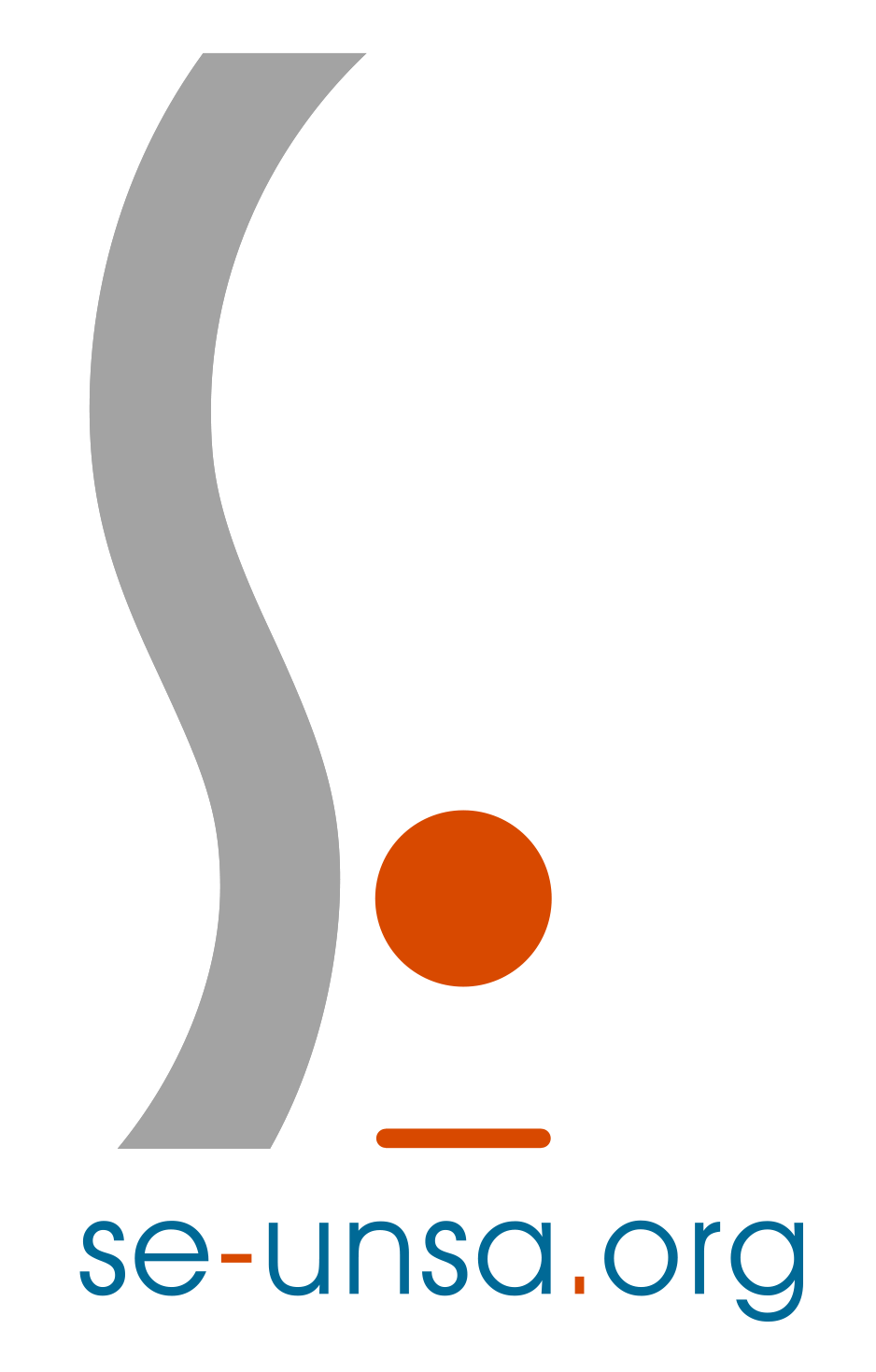L’administration est dans l’obligation de mettre en œuvre des mesures de protection et d’assistance pour tout agent public (parfois même sa famille) afin de le protéger et de l’assister s’il fait l’objet d’attaques ou de poursuites judiciaires dans le cadre ou en raison de ses fonctions.
Généralités concernant les notions de responsabilité
>> Responsabilité pénale
« L’institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Elle doit veiller à ce que les élèves ne soient pas exposés à subir des dommages, et n’en causent pas à autrui ». En d’autres termes, nous sommes responsables des dommages subis par nos élèves ou des dommages qu’ils causent à autrui.
Ainsi, la responsabilité pénale des agents n’est engagée que dans les deux cas suivants :
- violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Exemple : encadrement réglementairement insuffisant dans le cadre d’une sortie scolaire ;
- faute caractérisée exposant l’élève à un risque d’une particulière gravité que l’agent ne pouvait ignorer. Exemple : un élève qui reste seul dans le bassin d’une piscine sans surveillance.
Les tribunaux vont rechercher la responsabilité à engager. En pratique, le juge se posera les questions suivantes : le danger était-il prévisible, évitable ? De quels moyens l’agent disposait-il pour éviter le danger ? A-t-il pris les précautions adéquates ?
>> Responsabilité civile
Il y a une recherche de la responsabilité civile dans les cas où :
- l’agent commet une faute ou une négligence dans la surveillance qui entraîne un dommage pour un tiers (élèves, etc.) ;
- les élèves placés sous la surveillance d’un agent commettent un dommage au préjudice d’un tiers. Ce dommage peut être matériel (détériorations ou blessures par exemple) ou moral (atteinte à l’honneur). Dans tous les cas, il faut qu’il y ait un lien de causalité entre le fait (la faute) et le dommage.
La victime ou son représentant (parents) ne peuvent mettre en cause directement l’agent devant les tribunaux civils. La victime ne peut qu’attaquer l’État (dans un délai de 3 ans) qui l’indemnisera en cas de condamnation.
Cependant, si l’État estime que son agent a failli à ses obligations professionnelles (faute détachable du service), il peut demander à l’agent défaillant de rembourser tout ou partie des sommes versées par l’État aux victimes.
La protection fonctionnelle
La protection fonctionnelle peut être accordée :
- aux fonctionnaires (stagiaires et titulaires) et anciens fonctionnaires ;
- aux agents contractuels et anciens agents contractuels ;
- à la personne avec laquelle l’agent vit en couple, à ses enfants, à ses parents (uniquement si victime).
La demande de protection se fait par écrit auprès de la DSDEN.
L’administration peut refuser d’assister un agent si elle considère que l’action qu’il engage est inappropriée pour obtenir la réparation du préjudice.
En cas de difficultés, ne restez jamais seul·e ! Faîtes appel au SE-Unsa et à l’autonome de solidarité.