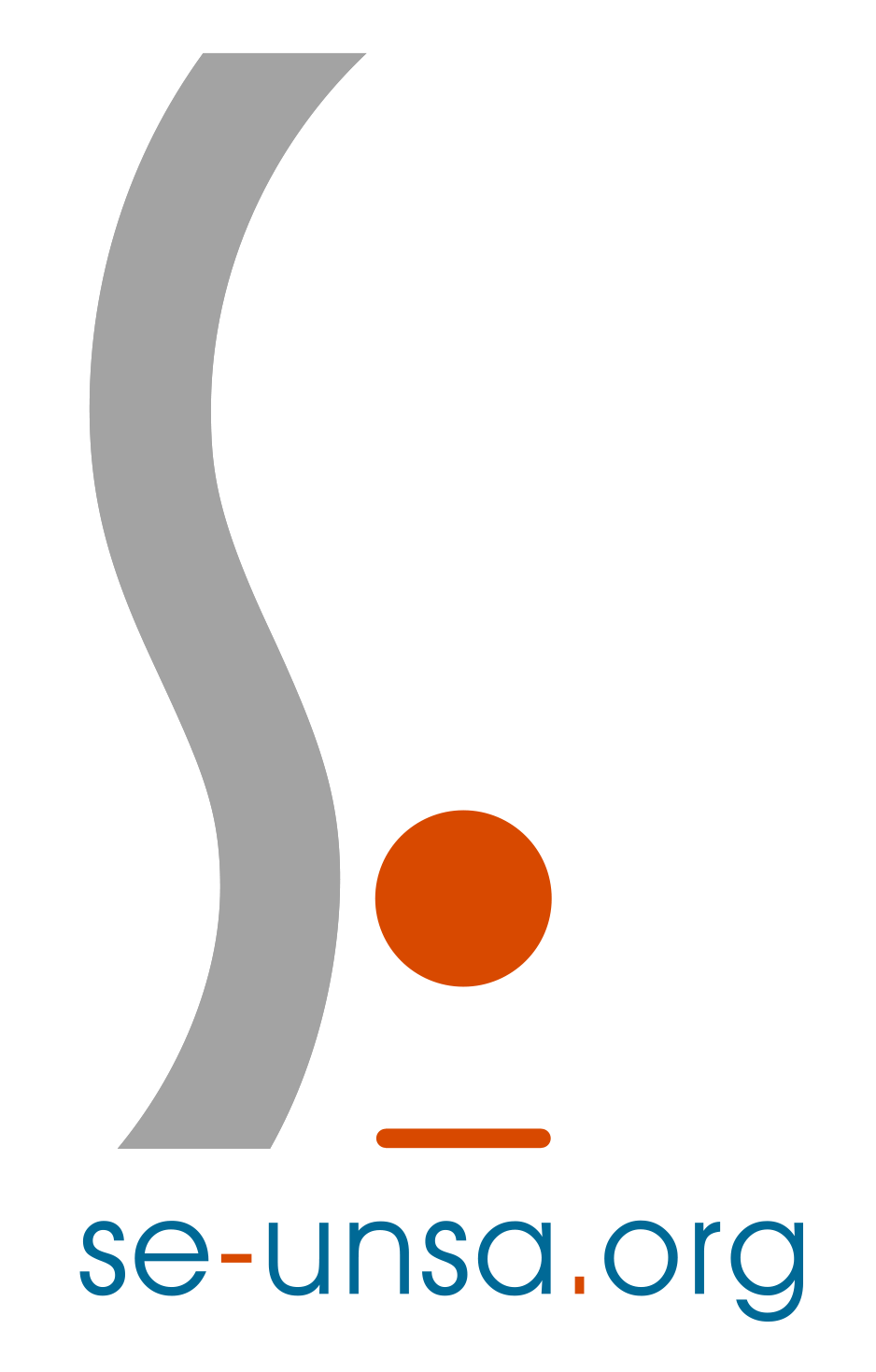Violenté·e, menacé·e, injurié·e, diffamé·e, victime de harcèlement du fait de vos fonctions, vous pouvez bénéficier de la protection fonctionnelle.
>> cette protection peut s’étendre aux membres de votre famille s’ils sont eux-mêmes victimes d’attaques ;
>> si vous avez commis une faute personnelle dans le cadre de vos fonctions, vous ne pouvez pas en bénéficier.
>> La dernière circulaire départementale (mars 2024) sur la protection fonctionnelle
Quelle est la procédure ?
L’agent doit solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de l’employeur via un courrier : >modèle<
Il faut fournir :
– un rapport relatant les faits de manière circonstanciée,
– une copie de la plainte ou du dépôt de plainte ou de main courante, le cas échéant,
– tout document ou témoignage à l’appui de la demande de protection,
– en cas de dommage sur véhicule, une copie de la plainte et de la carte grise.
Quelle est la réponse de l’administration ?
– L’agent est informé par écrit de la suite donnée et des modalités en cas d’acceptation,
– En cas de refus ou d’absence de réponse dans un délai de 2 mois qui vaut refus, l’administration informe et précise le motif du refus et indique les voies et délais de recours.
Les frais d’avocat ?
L’agent est libre du choix de son avocat, le nom doit être communiqué rapidement à l’administration. Elle prend en charge les frais en fonction de la convention ou non établie et en cas d’accord de la protection fonctionnelle.
***
Le SE-Unsa conseille à chacun-e de prendre contact avec l’ASL de son département au préalable de toute démarche >coordonnées ASL 31<
Le dossier de l’ASL sur >la protection fonctionnelle<
*
Le SE-Unsa 31 accompagne ses adhérent-es dans leurs démarches

L’administration est dans l’obligation de mettre en œuvre des mesures de protection et d’assistance pour tout agent public (parfois même sa famille) afin de le protéger et de l’assister s’il fait l’objet d’attaques ou de poursuites judiciaires dans le cadre ou en raison de ses fonctions.
Généralités concernant les notions de responsabilité
>> Responsabilité pénale
« L’institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Elle doit veiller à ce que les élèves ne soient pas exposés à subir des dommages, et n’en causent pas à autrui ». En d’autres termes, nous sommes responsables des dommages subis par nos élèves ou des dommages qu’ils causent à autrui.
Ainsi, la responsabilité pénale des agents n’est engagée que dans les deux cas suivants :
- violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Exemple : encadrement réglementairement insuffisant dans le cadre d’une sortie scolaire ;
- faute caractérisée exposant l’élève à un risque d’une particulière gravité que l’agent ne pouvait ignorer. Exemple : un élève qui reste seul dans le bassin d’une piscine sans surveillance.
Les tribunaux vont rechercher la responsabilité à engager. En pratique, le juge se posera les questions suivantes : le danger était-il prévisible, évitable ? De quels moyens l’agent disposait-il pour éviter le danger ? A-t-il pris les précautions adéquates ?
>> Responsabilité civile
Il y a une recherche de la responsabilité civile dans les cas où :
- l’agent commet une faute ou une négligence dans la surveillance qui entraîne un dommage pour un tiers (élèves, etc.) ;
- les élèves placés sous la surveillance d’un agent commettent un dommage au préjudice d’un tiers. Ce dommage peut être matériel (détériorations ou blessures par exemple) ou moral (atteinte à l’honneur). Dans tous les cas, il faut qu’il y ait un lien de causalité entre le fait (la faute) et le dommage.
La victime ou son représentant (parents) ne peuvent mettre en cause directement l’agent devant les tribunaux civils. La victime ne peut qu’attaquer l’État (dans un délai de 3 ans) qui l’indemnisera en cas de condamnation.
Cependant, si l’État estime que son agent a failli à ses obligations professionnelles (faute détachable du service), il peut demander à l’agent défaillant de rembourser tout ou partie des sommes versées par l’État aux victimes.