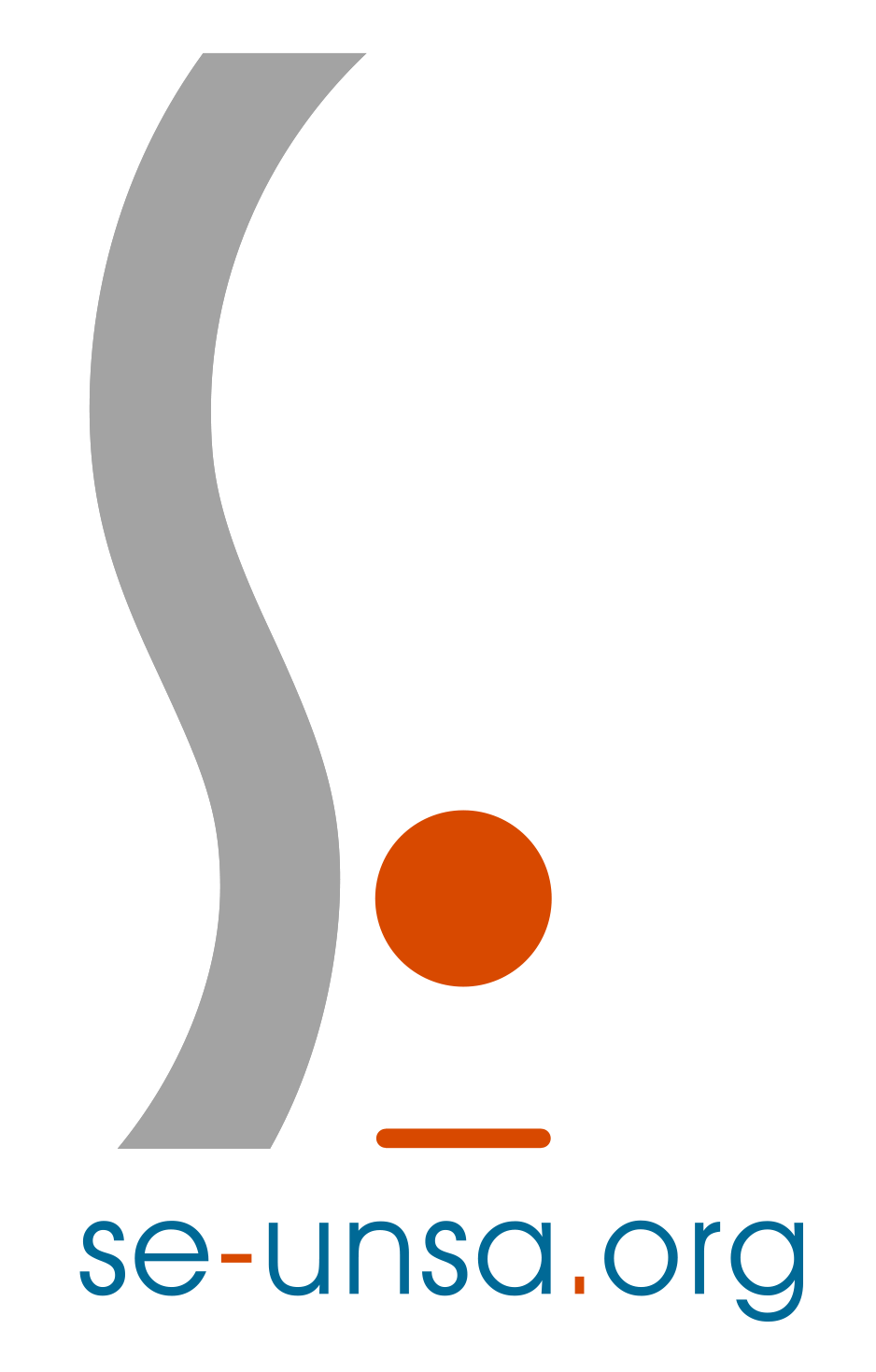L’inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers (Ébep), dans le premier comme dans le second degré, est aujourd’hui un enjeu central du système éducatif. Si elle constitue une avancée majeure vers plus d’égalité et d’ouverture, elle suscite aussi de fortes tensions dans le quotidien des AED, AESH, CPE, enseignants et PsyEN, comme le révèlent les résultats de notre enquête.
1er degré
L’inclusion à l’école primaire : un défi pour les personnels
L’inclusion des élèves à besoins éducatifs et pédagogiques particuliers à l’école primaire constitue un principe partagé, mais elle est vécue comme une réelle épreuve quotidienne par la majorité des professionnels. Près de 90 % des professeur·es des écoles et AESH déclarent des difficultés à gérer l’inclusion, qu’il s’agisse de l’organisation pédagogique, des relations avec les familles concernées ou du climat scolaire.
Les répercussions sont multiples :
78 % des répondants signalent une perturbation fréquente du fonctionnement des classes, accompagnée d’un fort impact sur la santé physique et psychique. En effet, 60 % affirment ressentir de l’angoisse à l’idée de se rendre à l’école et 78 % évoquent des conséquences physiques tangibles. On observe dans les réponses :
- Des situations d’arrêts maladie
- Une exposition accrue aux agressions, que celles-ci soient
– verbales, notamment en élémentaire où 61 % des personnels s’y disent confrontés ;ou
– physiques, pour 67 % des directeurs et directrices et pour 77 % des répondants exerçant en maternelle, qui ont été mordus ou frappés par un élève.
- À cela s’ajoutent des douleurs liées aux postures, citées par 63 % des répondants exerçant en maternelle (+20 points par rapport à l’élémentaire).
Enfin, il apparait que jusqu’à 70 % des enseignant·es ont besoin d’information et d’accompagnement concernant la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail, faute de quoi leur sentiment d’insécurité professionnelle s’alourdit davantage.
Pour remédier à ces difficultés, les personnels formulent des demandes convergentes :
- baisse des effectifs par classe dans 78 % des avis exprimés ;
- renfort de personnels médico-sociaux pour 77 % ;
- accès à plus de formations spécifiques pour 62 % ;
- dotation en matériel pédagogique adapté pour 58 % ;
- temps de concertation institutionnalisés entre équipes éducatives et personnels médico-sociaux pour 55 %.
Du côté de la direction d’école, les revendications les plus souvent citées sont : plus de moyens humains qualifiés, moins d’élèves par classe en présence d’Ébep, davantage de places en structures adaptées quand la scolarisation en milieu ordinaire est inadaptée, des formations pour tous et toutes, un traitement administratif plus agile et un accompagnement institutionnel effectif.
L’inclusion à l’école primaire, même si elle n’est pas remise en cause dans ses principes par les personnels répondants, appelle donc un soutien nettement renforcé de l’institution afin d’en faire un véritable levier de réussite scolaire pour tous et toutes.
2nd degré : collège et lycée général et technologique
Des professeurs principaux plus exposés
Les professeurs principaux vivent l’inclusion des Ébep plus difficilement que leurs collègues du secondaire. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : leur ressenti négatif est 1,5 fois supérieur à celui des autres enseignants. La gestion de l’inclusion leur apparaît plus complexe, notamment dans la relation avec les familles des élèves concernés, un point qui revient comme un obstacle majeur. Autre constat préoccupant : les professeurs principaux déclarent ressentir plus d’angoisse que leurs collègues au moment d’aller travailler. En revanche, l’impact des Ébep sur leur santé physique reste relativement faible.
Une demande accrue de travail en équipe et de formation
Dans le secondaire, pour mieux accompagner la réussite des Ébep, les enseignants expriment le besoin de travailler davantage en équipe éducative. Cette demande dépasse même celle formulée dans le premier degré. Le climat d’entraide semble également plus fragile dans le secondaire que dans le primaire : les enseignants du 2d degré se soutiennent moins entre eux. À cela s’ajoute un sentiment de manque de soutien de la hiérarchie, qui, de fait, est moins sollicitée par les professeurs principaux. En parallèle, les enseignants revendiquent plus de formation spécifique et une baisse des effectifs en classe, conditions jugées indispensables pour mieux accompagner les Ébep, sans oublier un matériel adapté qui, pour un enseignant sur deux, manque cruellement.
Une méconnaissance inquiétante des dispositifs de protection
Certains chiffres alertent : la méconnaissance du registre DGI (danger grave et imminent) et du dispositif de protection fonctionnelle reste majoritaire parmi les enseignants. Cela révèle un déficit d’information et de sécurisation, alors même que ces outils existent pour protéger les personnels.
2nd degré : lycée professionnel
Les élèves en situation de handicap sont 5 fois plus nombreux en lycée professionnel qu’en lycée général et technologique. Par leur grand nombre mais aussi leur diversité de profil et de besoins, il devient très complexe de gérer cette inclusion d’autant que peu de PLP sont formés à l’accueil des Ébep. En effet, 83 % des interrogés disent que l’inclusion perturbe leur gestion de classe et 93 % qu’elle perturbe leur capacité à accompagner tous les élèves… Notre enquête menée auprès d’enseignants de lycée professionnel nous donne donc des chiffres concrets et met en lumière cinq enjeux majeurs à prendre en compte pour rendre l’inclusion efficace, durable et bénéfique pour tous.
Inclusion des Ébep : cinq leviers essentiels selon les enseignants de lycées professionnels
1. Des moyens humains et financiers renforcés
Les enseignants soulignent l’importance de recruter davantage d’AESH mieux formé·es et mieux rémunéré·es, avec des salaires décents. Ils insistent aussi sur la nécessité d’élargir le rôle des relais (enseignants référents, coordonnateurs Ulis, éducateurs spécialisés). Certains vont jusqu’à demander un adulte dédié pour chaque élève à besoins éducatifs particuliers afin d’assurer un accompagnement réellement adapté.
2. Des effectifs de classe adaptés
Les effectifs de classe sont un point central : les enseignants estiment qu’une classe de 12 à 15 élèves favoriserait un réel suivi individualisé. Ils insistent également sur la nécessité de limiter le nombre d’Ébep par classe pour permettre une véritable hétérogénéité et éviter l’entre-soi.
3. Une formation initiale et continue adaptée
La majorité des enseignants exprime le besoin urgent d’une formation solide et concrète sur l’inclusion, intégrée dans leur temps de service. Elle devrait être en lien avec des professionnels du médico-social, et pensée en fonction des disciplines enseignées. Une décharge horaire est également jugée indispensable pour travailler collectivement aux adaptations pédagogiques.
4. Une reconnaissance du temps et de l’investissement
Inclure un Ébep demande aux professeurs une préparation accrue : 60 % disent y consacrer environ 2 heures supplémentaires par semaine, tandis que 10 % y passent même plus de 10 heures hebdomadaires. Pourtant, cette charge spécifique n’est pas valorisée. À plus de 95 %, les collègues de lycée professionnel réclament donc une reconnaissance institutionnelle, y compris financière, pour un travail qui dépasse largement leurs missions habituelles.
5. Des coopérations et une communication encore insuffisantes
L’enquête révèle des fragilités dans la communication et les partenariats : plus de 70 % des professeurs affirment ne jamais échanger avec les professionnels de santé sur le parcours de soins des élèves, et 50 % constatent une faible communication avec les familles. Ce manque de coopération alourdit la responsabilité des enseignants, qui redoutent de devoir assumer seuls des rôles relevant normalement d’autres métiers.
L’inclusion est reconnue par beaucoup de PLP comme une opportunité pour lutter contre les inégalités, mais elle ne peut reposer uniquement sur leur bonne volonté. Sans effectifs adaptés, sans formation, reconnaissance et dialogue entre tous les acteurs, elle risque de devenir une charge intenable, avec un impact négatif pour les élèves comme pour les équipes éducatives. D’ailleurs, les chiffres montrent que pour 25 % des PLP, l’accompagnement des Ébep a un impact sur leur santé mentale et génère une angoisse au travail.
AESH
L’École inclusive est aujourd’hui au cœur des politiques éducatives françaises. Mais qu’en pensent celles et ceux qui la vivent au quotidien ? Les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH), maillons essentiels de cette inclusion, ont répondu à une enquête portant sur leurs attentes, leurs constats et leurs propositions d’amélioration.
Les très nombreuses réponses analysées dégagent des tendances fortes sur les besoins exprimés par les AESH.
La rémunération, une préoccupation principale
79,6 % des répondants AESH estiment que leur rémunération est insuffisante : Avoir une rémunération décente, une reconnaissance du métier avec une meilleure rémunération, une rémunération à la hauteur de nos missions…
Près de 8 répondants sur 10 estiment que leur rémunération est insuffisante. Cette donnée confirme un sentiment largement partagé dans la profession : la rémunération actuelle ne reflète ni le niveau d’engagement, ni les responsabilités confiées aux AESH. Ces dernier·ères jouent un rôle essentiel dans l’inclusion scolaire mais continuent de se heurter à une précarité persistante.
Ainsi, l’augmentation salariale se place en tête des priorités exprimées par les AESH. Elle apparaît comme une condition incontournable pour assurer la pérennité et la qualité de l’accompagnement scolaire.
La formation, une priorité absolue
62,1 % des répondants AESH estiment avoir besoin de formation : Avoir des formations spécifiques adaptées aux besoins des élèves, une formation continue digne de ce nom…
Les AESH soulignent massivement le manque de formation initiale et continue. Ils réclament une préparation plus complète à la diversité des situations rencontrées, une formation adaptée aux différents élèves qu’ils/elles accompagnent.
Mais aussi une formation conjointe avec les enseignants pour favoriser une meilleure compréhension des besoins éducatifs particuliers, et un travail en équipe.
Un meilleur suivi et un respect des notifications
25,1 % des répondants AESH demandent un meilleur suivi et le respect des notifications MDPH : J’accompagne 8 élèves, les élèves ont 2 à 3h d’accompagnement chacun, on baisse les heures de l’un pour habiller l’autre, sans se soucier des besoins de l’enfant…
Le troisième point majeur est lié aux notifications MDPH et à leur mise en œuvre. Les AESH déplorent un suivi insuffisant et un manque de cohérence dans la prise en compte des besoins des élèves. Ils/Elles demandent aussi davantage d’heures d’accompagnement par élève et la possibilité d’un suivi plus individualisé.
Ils/Elles souhaitent une meilleure coordination entre les équipes éducatives et médico-sociales, ainsi qu’une réelle écoute de leur expertise de terrain.
Les AESH soulignent le manque de moyens humains et matériels : effectifs insuffisants, absence d’équipes pluridisciplinaires, matériel adapté manquant.
Les accompagnements doivent correspondre à un besoin réel et non à une politique budgétaire.
Si l’École inclusive est une ambition partagée et affirmée par les politiques publiques, elle ne pourra se concrétiser pleinement sans une reconnaissance réelle et durable du rôle des AESH. Améliorer leur statut, investir dans leur formation et renforcer la cohérence du suivi ne sont pas des options, mais des conditions essentielles pour garantir une inclusion scolaire de qualité, au service des élèves comme de la communauté éducative dans son ensemble.
PsyEN
Les résultats de cette enquête montrent que nombreuses et nombreux sont les PsyEN à se sentir impliqué·es et engagé·es pour accompagner l’inclusion au sein des écoles et établissements.
Pour 80 % des PsyEN, les processus d’inclusion dans leurs conditions actuelles d’exercice sont difficiles voire très difficiles. La lourdeur de leurs secteurs d’intervention, le manque de place dans les structures de soins, le manque de temps d’échange avec les professionnels soignants, le manque d’infirmiers et médecins scolaires, de soutien de l’institution… pèsent sur la qualité des accompagnements proposés aux élèves à besoins éducatifs particuliers.
Conséquences en chaîne, 76 % des PsyEN affirment manquer de temps pour exercer leurs missions en Rased auprès des élèves en grande difficulté, ou en CIO auprès de jeunes qui ont besoin de ces lieux et de leur expertise.
50 % des répondants ressentent les effets de ces conditions de travail particulièrement dégradées sur leur santé mentale, de l’angoisse notamment.
Les mots qui reviennent et qui représentent le mieux pour les PsyEN l’inclusion des élèves à besoins particuliers parlent malheureusement d’eux-mêmes : maltraitance – souffrance – solitude – épuisement – complexité.
Afin de vous accompagner au mieux, nous avons travaillé collectivement et démocratiquement pour élaborer des mandats à la hauteur des enjeux, de vos enjeux dans vos écoles et établissements.
Les mandats du SE-Unsa :
L’évaluation et l’analyse des situations par les PsyEN sont indispensables afin que les réponses pédagogiques et éducatives apportées aux élèves soient les plus adaptées à leurs besoins. Cet éclairage est précieux pour les équipes et les familles. Pour ce faire, en cas de besoin, le SE-Unsa souhaite qu’ils puissent bénéficier de temps institutionnels entre pairs. C’est pourquoi le SE-Unsa revendique la constitution d’un Service public de psychologie au sein de l’Éducation nationale, qui puisse répondre aux besoins des élèves et garantir la proximité d’intervention des psychologues.
Et pour les PsyEN EDA, le SE-Unsa revendique la création d’un interlocuteur privilégié et de proximité qui pourrait prendre la forme d’un conseiller technique psychologue en rapport avec l’exercice de leur métier.
Le SE-Unsa revendique le développement d’un service de santé scolaire (médecins et infirmiers) pour que chaque enfant ou chaque jeune puisse bénéficier de visites médicales ou infirmières permettant de mettre en œuvre une politique de prévention et de dépistage efficace. L’équipe pédagogique doit pouvoir solliciter à tout moment le service de santé scolaire.
La grande difficulté scolaire doit être prise en charge par des personnels spécialisés. Les Rased, dont c’est la mission, doivent être complets (composés d’enseignants spécialisés pour l’aide à dominante relationnelle et l’aide à dominante pédagogique, et de PsyEN EDA). Ils doivent être présents en nombre suffisant, en respectant un maillage territorial équilibré, pour intervenir à tout moment de la scolarité, prévenir l’apparition de difficultés et y remédier lorsqu’elles persistent, et ce dès la maternelle. Ils doivent disposer des moyens suffisants pour réaliser toutes leurs missions.
Dans le 2d degré, le SE-Unsa revendique la création de Rased afin d’améliorer la prise en charge des élèves en grande difficulté scolaire qui ne peut pas être seulement assumée par les enseignants spécialisés déjà affectés à d’autres missions, ni par les enseignants non spécialisés. Les enseignants spécialisés restent néanmoins des personnes ressources pour leurs pairs.
Vie scolaire
Nos collègues répondants exercent les métiers d’AED ou de CPE. On peut supposer que les professionnels qui ont pris le temps de répondre à cette enquête spécifique sont des personnes déjà sensibilisées au sujet. S’ils sont 80 % à ne vivre l’inclusion ni comme très facile ou très difficile, ils sont pourtant 60 % à relever qu’ils rencontrent des difficultés de gestion.
Ces difficultés de gestion sont présentes notamment dans la relation avec les familles d’enfants relevant de l’inclusion, qui est perçue de façon équivalente par l’échantillon de répondants comme facile et difficile. La concertation entre l’équipe éducative et les soignants est perçue comme un besoin prioritaire, et la baisse des effectifs en classe ordinaire l’est également (plus de 60 % de réponses pour chaque occurrence).
En matière d’impact sur la santé mentale des personnels de vie scolaire, on peut noter que 70 % n’en perçoivent aucun et 25 % font part d’une angoisse à aller au travail, liée à l’inclusion scolaire.
Concernant l’impact sur la santé physique des personnels de vie scolaire : aucun pour 80 % et des douleurs à la suite de postures répétées ou des blessures superficielles pour les autres. Ces réponses sont à corréler avec l’âge des enfants scolarisés : en collège ou lycée, soit l’élève est autonome physiquement, soit les mesures de compensation sont mises en place.
49 % des répondants vie scolaire reportent avoir été l’objet d’une agression verbale par un Ébep et 28 % par une famille dans le cadre de l’inclusion. 20 % en ont parlé à leurs proches, 34 % à leurs pairs, et 55 % à leur hiérarchie.
Dans le cadre des difficultés rencontrées, 24 % ont reçu du soutien par leurs pairs, 53 % par leurs collègues, et 42 % par la hiérarchie directe.
Les différents dispositifs d’alerte (RSST, DGI, ou PF) ne sont pas utilisés car jugés inappropriés. Les réponses à l’enquête donnent à voir un déficit de connaissance de l’utilisation du DGI (20 % des répondants), voire d’information quant à son contenu (65 %). En matière de protection fonctionnelle (PF), au-delà du fait que cela ne semble pas approprié pour les problèmes liés à l’inclusion, 45 % des répondants indiquent ne pas savoir comment ça marche et, pire, 50 % indiquent ne pas connaître. C’est un déficit d’information des personnels que l’institution se doit de s’employer à combler.
En matière d’échanges avec les familles sur le parcours de soin des élèves, les répondants AED disent ne pas en avoir, ou insuffisamment (près de 90 % des réponses). Pour ce qui est des CPE, 42 % disent en avoir insuffisamment et 42 % régulièrement.
Pour les échanges avec les professionnels sur le parcours de soin des élèves, 85 % des AED indiquent ne pas en avoir ou insuffisamment. Les CPE répondants en ont à 25 %, et 41 % en ont insuffisamment.
Dans ce domaine du soin, une réflexion est probablement encore à construire sur la nature des informations à partager, et veiller à ne partager que celles qui sont strictement utiles à la prise en charge de l’élève dans le cadre de l’inclusion scolaire. L’équilibre est à trouver entre ce qui va permettre à chacun des métiers de vie scolaire d’exercer ses missions tout en respectant le secret médical : l’exercice est ardu.
Dans l’espace d’expression libre du questionnaire rempli par les personnels de vie scolaire, les besoins relevés sont les suivants :
- Avoir davantage de moyens humains (AESH et personnels médico-sociaux notamment).
- Mettre en place d’une formation (initiale et continuée) de qualité, mais aussi avoir plus d’information sur les dispositifs existants de signalement d’un problème et des possibilités de demander de l’aide, tant pour les enseignants que les autres personnels.
- Effectuer un travail sur le nombre d’élèves par classe (réduction), pour pouvoir accompagner à la fois les enfants à besoins particuliers et les autres.
- Apporter de l’aide administrative pour les dossiers et les aménagements d’examen.
- Cesser le glissement des missions dû au manque de personnels.
Tout ceci est nécessaire afin de sortir du « bricolage », pour pouvoir faire mieux, atteindre les objectifs dans le cadre de l’inclusion tant pour les élèves concernés que les élèves « ordinaires », mais aussi pour les personnels. Il n’est jamais satisfaisant de se trouver dans une sorte de maltraitance et de ne pouvoir tendre vers une égalité des chances réelle.
L'avis du SE-Unsa
Les résultats de l’enquête du SE-Unsa mettent en évidence les préoccupations majeures des personnels confrontés à l’inclusion scolaire, quel que soit leur métier ou leur lieu d’enseignement : l’insuffisance des moyens mis à disposition, le manque de formation et d’information, les effectifs trop lourds, sont autant de freins à une prise en charge sereine et efficace des enfants en situation de handicap et à besoins éducatifs particuliers.
Le SE-Unsa demande la prise en compte de ces difficultés, en s’opposant à la disparition des établissements spécialisés, en exigeant des personnels en nombre suffisant, en poursuivant le développement des Ulis dans le second degré, en revendiquant que les dispositifs d’inclusion soient accompagnés de moyens de fonctionnement à la hauteur de leurs missions, de personnels pérennes, formés et en nombre suffisant – qui ne soient pas qu’en appui des équipes pédagogiques mais qui soient en mesure de prendre en charge des élèves nécessitant un encadrement individuel – de PsyEN et d’agents publics du secteur médico-social ou du personnel des établissements médico-sociaux.